Une croisière sur le lac Nasser
L’Aire, 2012 Entre les lignes, 20 juin 2012, entretien avec Anik Schuin et Jean-Marie Félix sur RTS Espace 2.
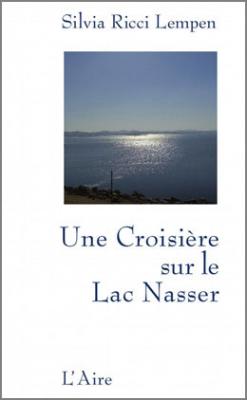
Morts (symboliques) sur le Nil
par Isabelle Rüf
Le Temps, samedi 7 juillet 2012
Silvia Ricci Lempen est la chroniqueuse ironique des dérives sémantiques et sexistes que les lecteurs du Temps connaissent. C’est aussi une romancière qui prend un plaisir contagieux à raconter des histoires. Celle qui unit les membres du «groupe de touristes francophones indépendants» se déroule au long de trois journées, dans le huis clos d’un bateau de croisière en Egypte, en novembre 2008. Ce genre de lieu, hors temps, hors milieu, est propice aux crises et aux dévoilements. Il y aura des morts le quatrième jour, mais des morts sociales, symboliques, humiliantes et pernicieuses. On les voit se préparer et s’accomplir à travers les monologues intérieurs de quatre participants. Marlène, l’observatrice, est une vieille dame lucide dont la vie a été dure et qui en garde de l’amertume. Charles-Etienne, célibataire grandi à l’ombre d’une mère qui n’en voulait pas, est de trop partout, maladroit et conscient de l’être. Marie a besoin de repos et de désir. Elle a payé de sa vie amoureuse la réussite de sa carrière de cheffe d’un restaurant connu. Elle est belle, débordante d’hormones. Dans son sillage, Steph, qui l’aime en vain, gêne sa quête du mâle. Luis connaît l’ivresse du succès, même provincial, c’est un homme de médias, un beau macho prévisible.
Trois jours de frôlements, d’exaspération des désirs, de trahisons: ces gens ordinaires développent des stratégies divertissantes pour faire advenir un peu d’extraordinaire le temps de cette parenthèse. Deux y parviendront, quatre vont souffrir durablement. La romancière ne les rend pas ridicules, ils le sont naturellement – comme tout le monde dans ces circonstances – sous le regard sévère du maître d’hôtel égyptien, sans doute moins indulgent qu’elle.
Etrangement, le roman s’ouvre par quelques belles pages qui évoquent le dernier concert et la mort de Myriam Makeba, ainsi que le massacre de plusieurs Africains, au même moment, près de Naples. Une mise en perspective des drames minuscules des touristes? Au lecteur d’interpréter.
Derrière le miroir
par Anne Pitteloud
Le Courrier, samedi 14 juillet 2012
Le bateau glisse sur l’eau immobile, dans le paysage désertique de la Haute-Egypte, sous un soleil implacable. Direction: Abou Simbel et ses temples antiques sauvés des eaux lors de la construction du barrage d’Assouan. Le temps s’étire, suspendu, tout comme les vies des protagonistes de ce huis clos luxueux: dans cette vacance de quelques jours volée à leur quotidien se déploient leurs désirs, espoirs, attentes et souvenirs. Quatre d’entre eux vont se rencontrer ou se rater, tisser entre eux des liens réels ou imaginaires, tandis que la croisière déroule ses plages de lenteur et de vide dans la lumière aveuglante. Silvia Ricci Lempen leur donne la parole dans son quatrième roman, le polyphonique Croisière sur le Lac Nasser, qui vibre d’une atmosphère lourde et sensuelle.
Il y a Maria, belle et solaire, qui dirige un grand restaurant, venue se détendre flanquée de son amie Stéphanie. Celle-ci, amoureuse d’elle, s’avère un poids: elle l’a soutenue lors de sa rupture et supporte mal le désir de Maria pour le ténébreux Luis. Les deux fantasment une nuit brûlante, dans un jeu de regards et de tension prometteur: la voix de Luis fait ainsi écho à celle de Maria – l’animateur radio est sur le bateau avec sa femme, loin des enfants –, et les deux sont observateurs autant qu’observés par Charles- Etienne et Marlene, autres participants du groupe francophone. Eternel célibataire, fils mal aimé, Charles-Etienne se sent transparent et inadapté tandis qu’il traîne sa doulou- reuse solitude et son corps trop maigre sur le ponton. Marlene, veuve habitée de fantômes, lui oppose une solitude différente, tissée de violence et d’échecs. Les deux noueront une amitié étonnante, profonde.
Dans ce cadre hiératique, sous le regard sérieux du guide égyptien, Silvia Ricci Lempen fait s’entrechoquer des univers en mettant en écho perceptions intérieure et extérieure des protagonistes. Le récit se construit par bribes suivant le flux des pensées de chacun, leurs points de vue divers formant un kaléidoscope d’anecdotes et d’émotions qui joue sur une vaste palette de nuances pour dire la complexité des relations – paradoxales, cocasses, pathétiques et touchantes, si fragiles. L’auteure romande excelle à restituer ces voix dans leur singularité, leur rythme et tonalité reflétant alors les remous qui travaillent âmes et corps. Et derrière les surfaces lisses comme un miroir couvent des tempêtes, qui finiront par troubler ce calme immémorial.
La croisière sur le lac Nasser de Silvia Ricci Lempen
par Alain Bagnoud
Blogres, le blog d’écrivains en partenariat avec La Tribune de Genève
Le 9 novembre 2008, Myriam Makeba s’écroule au moment des saluts, après un concert de soutien à Roberto Saviano, écrivain poursuivi par la camorra à cause de son roman Gomorra. A bout de forces, ne se déplaçant plus qu’en chaise roulante, la chanteuse sud-africaine, icône de la lutte anti-apartheid, a accepté de se produire dans la petite ville de Castel Volturno pour protester contre un crime raciste qui s’y est déroulé quelques semaines auparavant. Un commando d’hommes blancs déguisés en policiers a massacré à la kalashnikov cinq Africains dans l’atelier de couture que gérait l’un d’entre eux. Le lendemain, une foule immense d’immigrés indignés a bloqué la ville. Roberto Saviano au nom des militants anti-camorra, a relevé qu’elle montrait l’exemple aux Italiens du coin qui, eux, s’arrangent du système mafieux et du racisme.
Le 14 novembre 2008, à l’aéroport d’Abou Simbel, des touristes qui terminent une croisière sur le Lac Nasser, privés jusque là des nouvelles du monde, apprennent la mort de la chanteuse. Elle les laisse plutôt indifférents. « C’est vrai qu’elle était vieille. Pata pata.»
Une Croisière sur le Lac Nasser, se déroule entre ces deux bornes temporelles. Silvia Ricci Lempen, écrivaine rare mais couverte de prix, y suit le voyage organisé d’un groupe d’Européens en quête des vestiges de l’Egypte éternelle.
Le roman, très bien écrit, est encadré par ces deux passages en narration externe qui racontent la mort de Myriam Makeba et l’attente de l’embarquement. Mais le récit central se compose pour l’essentiel des monologues intérieurs de quatre personnages principaux.
Luis, beau journaliste, accompagné de sa femme, voit son couple se défaire pendant qu’il fantasme une aventure avec la belle Marie. Celle-ci, réceptive à son désir, le partageant, est accompagnée par une amie pharmacienne lesbienne et désespérément amoureuse d’elle, dont l’état de santé psychique se délabre tout au long du voyage.
Si ce couple échoue à se rejoindre, ce n’est pas le cas de l’autre paire de personnages principaux, qui nouent une amitié inattendue. Marlène est une vieille dame, Charles-Etienne un homme coincé, maladroit, un peu simple, vendeur de jouets, un de ces êtres peu adaptés à la société de la concurrence et du profit.A travers les regards de ces voyageurs, on suit les incidents de la croisière, mais aussi les relations qui se créent, se tendent, les évaluations et les convoitises, les attentes et les déceptions. L’entrelacement des points de vue crée une tension progressive. Quelque chose se prépare, va se passer.
Mais ce qui arrive finalement, le drame conclusif, n’est pas du tout celui que le lecteur attend. Les personnages sont rattrapés par le monde extérieur, par ce qui se passe là où ils ne sont pas, ailleurs que dans cette bulle lente du voyage organisé…
Finalement, le bilan du circuit laisse aux personnages plus d’attentes et d’espoirs que de réalisations. Les amours ont échoué, les désirs sont restés vains, les familles se sont disloquées, les carrières ont patiné : Une Croisière sur le Lac Nasser est un livre désillusionné. Serait un livre désillusionné s’il n’y avait pas cette amitié forte entre la vieille dame et le jeune paumé.
Nous vivons dans un monde difficile et violent, semble dire Silvia Ricci Lempen, les relations y sont compliquées, les désirs contrariés, les drames fréquents. Mais rien n’est perdu tant que de l’estime, de la fraternité, de l’entraide, de l’attachement peuvent se nouer entre des gens que tout semble séparer.
Destins croisés sur fond noir
par Catherine Seylaz
Domaine Public, 18 juillet 2012
Silvia Ricci Lempen a publié trois romans aux éditions de l’Aire entre 1991 et 2000, chacun couronné d’un prix (Un homme tragique, prix Dentan 1991; Le sentier des éléphants, prix Schiller 1996). C’est dire si la valeur de l’œuvre est reconnue, alors même qu’elle n’est pas d’une lecture dite «facile», en particulierAvant (2000), roman ambitieux sur les rapports problématiques entre la création artistique et le désespoir ontologique, récompensé par le prix Paul-Budry.
«Ceux qui arrivaient dans un nuage de kérosène, portant des poulets pas encore plumés, des ballots de fripes, des végétaux comestibles ou non comestibles, aux feuilles pendant hors des paniers, ne semblaient pas venir du monde des merveilles – ils venaient d’où alors, puisque le monde des merveilles était le seul visible de l’embarcadère, l’île-jardin vert émeraude, le miroitement du Nil, la flottille ondoyante de barques ailées.»
Une croisière sur le lac Nasser, le dernier roman de Silvia Ricci Lempen, met en scène le récit de quelques vies privées, avec leurs préoccupations, leurs désirs, leurs chagrins, leurs humiliations et leurs pâles bonheurs fugitifs, sur fond d’évocation du destin des peuples exploités par notre civilisation mondialisée (tourisme, agroalimentaire, pillage des ressources naturelles), exploitation que subissent des millions d’hommes et de femmes de par le monde. Prenant pour exemple un groupe de touristes, Français, Belges, Canadiens, Suisses, en voyage en Egypte, elle choisit un moment précis de ce périple, la croisière sur le lac Nasser, qui a englouti des villages nubiens. Seul surnage le sommet des collines, lentes îles longées par le bateau, où ne subsiste aucune trace de vie, signes saisissants du meurtre d’une civilisation par une autre, celle des portables, des guides touristiques et des appareils de photos numériques.
Après un vigoureux prologue qui rappelle le massacre d’Africains par un commando d’hommes blancs à Castel Volturno, en Sicile, et la mort de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, venue soutenir la cause des immigrés africains et protester contre le coup de main en participant à un concert sur les lieux mêmes, on s’attendait à un roman politique. Mais, surprise, la narratrice donne aussitôt après la parole à quatre des membres du groupe de touristes en croisière, sous la forme de monologues intérieurs où chacun d’entre eux raconte comment il ou elle vit ce fragment de voyage. On passe donc d’une perspective surplombante à un discours intimiste, dont la forme choisie n’est pas sans dangers.
J’en vois deux, qui ne sont pas toujours évités ici. Le premier, c’est que chaque «narrateur» ne trouve pas sa voix propre, ce qui a pour effet que tous les monologues ont le même ton et finissent par renvoyer trop visiblement à la voix de l’auteure. Heureusement, ce n’est généralement pas le cas dans ce roman: les uns et les autres ne se différencient pas seulement par leurs préoccupations, les bribes de leur passé ou leurs projets pour l’avenir, mais ils possèdent souvent un vocabulaire et un rythme qui leur sont propres. Deuxième écueil: le monologue intérieur réclame impérieusement que ce qui est dit, vu et senti soit de la stricte compétence du personnage qui parle. Pas de tirade sur la culture par un personnage un peu rustre, pas de description somptueuse du paysage par quelqu’un qui s’est avéré peu sensible à la beauté de la nature, etc. Je dirais qu’ici, les quelques rares infractions à la règle nous permettent, par ricochet, d’apprécier le chatoiement de l’écriture de l’auteure ou sa verve ironique.
Trois «couples» se dessinent peu à peu au travers du récit des quatre «narrateurs». Deux sont déjà constitués au début, Marie et Steph, les deux Françaises, et Mélanie et Luis. Ce sont ceux qui vont exploser au cours de la croisière. En revanche, le dernier ne se forme que progressivement, couple improbable au sein duquel vont se rejoindre Marlène, d’origine allemande, veuve et mère d’un fils voyou, et Charles-Etienne, fils bâtard mal aimé de sa mère, l’un et l’autre «étrangers» et amputés affectifs. Le lent rapprochement de ces deux êtres malmenés par la vie est un des très beaux fils rouges du roman, accompagnant le lent défilement des collines noyées, méditation sur le contraste entre le temps humain et le temps immémorial de la terre.
Ce temps immémorial est aussi celui des Nubiens, aux gestes élégants et à la peau de soie noire, muets et dignes dans leurs modestes fonctions de serveurs, garçons de cabine, transporteurs de touristes, et qui constituent le fond sur lequel s’agitent les passions dérisoires des Occidentaux.
Roman sur le temps, sur l’altérité, sur la beauté de la terre et son exploitation touristique, ce livre n’est pas tendre envers l’espèce humaine. Le seul moment où Luis le bellâtre tente de vitupérer «l’égoïsme des nantis», il est ivre, et ses propos se perdent dans l’indifférence et la gêne générales. Comme pour Marlène, le personnage le plus proche, me semble-t-il, de la narratrice, l’espoir est mince et les illusions perdues. Restent la tendresse et la solidarité individuelle, seul recours, dans un monde déserté, pour les humiliés et les offensés.
Un huis clos à hublots fermés
par Anne Mooser
La Liberté, 11 août 2012
Sur un bateau qui lentement promène ses touristes alanguis par l’étourdissante chaleur du soleil égyptien, se déroulent des conversations de boudoir futiles, des séances de bronzage parfaitement huilées, des repas à l’atmosphère feutrée, alors que d’élégants serveurs nubiens emplissent les tasses dorées d’un thé à la menthe rafraîchissant. Mais sous cette somnolente torpeur couvent frustrations et rancunes, regrets et souvenirs douloureux; le désir aussi, dont l’inassouvissement creuse davantage encore les plaies de ces touristes réunis là par le hasard, mais que les affinités ou le manque de celles-ci ont tôt fait de rapprocher, ou d’opposer.
L’enfer, c’est les autres, Sartre ne l’avait-il pas dit? Et dans ce nouveau roman de Silvia Ricci Lempen, où se croisent fort habilement les voix contrastées et colorées d’un petit groupe de passagers, nul ne peut échapper au regard de «l’autre». Davantage encore, de ce huis clos à hublots fermés, nul ne sortira indemne. La bulle de désespoir qui ne cessait de grossir et d’enfler au fil des jours finira par crever, mettant à nu les visages, certains pitoyables, des protagonistes. D’autres au contraire, touchants dans leur mal-être, écorchés par la vie, révèlent une force jusqu’alors inconnue, gagnant ainsi en profondeur. Une croisière qui n’a de tranquille que le doux clapotis du lac, même si les voyageurs, perdus dans les remous de leurs drames intimes, restent sourds au bruit du monde.